Une certaine déception en particulier pour ce qui concerne l’hôtellerie et la restauration. Un arbitrage semble avoir été fait par les touristes au bénéfice des rivages du nord du pays et de l’intérieur des terres, perturbant les prévisions pour notre région. Les responsables du secteur doivent cependant, pour ma part, revoir notamment leur politique de prix dans l’hôtellerie et la restauration.
Notamment sur la partie liquide dans les nombreux endroits gourmands… Trop c’est trop…
Il suffisait de lorgner sur les tables de restaurant du bassin et de toute la Nouvelle Aquitaine d’ailleurs pour constater la diminution d’intérêt pour la dive bouteille. Un verre suffit désormais pour beaucoup… C’est inquiétant mais beaucoup aujourd’hui préfère encore fermer les yeux… Quand vous trouvez au restaurant un vin que vous connaissez avec un coefficient de marge de 5 par rapport au prix d’achat, cherchez l’erreur. Heureusement cependant, certains ont compris et leur succès est bien souvent probant. La bière est désormais aussi omniprésente…Un concurrent redoutable s’il en est. Heureusement, le rosé de Bordeaux mais aussi le Crémant semblent avoir conquis un nombre croissant de restaurateurs. Enfin…
Quand aux visites et ventes dans les propriétés, le bilan est mitigé mais prématuré car septembre est très souvent un mois clé.
Depuis fin août, les vendanges ont démarré sous de bonnes conditions climatiques. Pour les effervescents, blanc et rosé, ce fut parfait. Place aux vendanges des raisins rouges désormais qui ont été touchés de manière inédite par le mildiou. Et de manière très hétérogène d’ailleurs. Les pertes sont estimées par endroits entre 20 à 60%. Pour beaucoup ce sera donc fort difficile.
Quelque soit les méthodes culturales d’ailleurs, certains ont réussi à maîtriser le fléau et d’autres pas… Il semblerait cependant que les secteurs plus ventilés soient moins touchés.
Triste mine et sourire cohabitent donc souvent de manière étonnante. Patientons donc quelque peu pour afficher un bilan plut complet…
Coté qualitatif par contre, les sourires sont beaucoup plus nombreux… Les pluies de la mi-août y ont largement contribué. Depuis, le soleil est de la partie et les nuits sont devenues plus fraîches.. Il faut cependant s’attendre à de hauts degrés notamment en ce qui concerne le merlot. Il est un peu tôt pour être plus précis mais l’optimisme est de règle sur tout le vignoble bordelais mais aussi celui de Dordogne et du Lot et Garonne.
Une autre ombre plane sur certaines régions et notamment l’Entre-Deux-Mers… Que deviendront les vignes abandonnées, en friche et même non récoltées ? On parle de plus de 10.000 ha.
Une situation incroyable il y a encore quelques années dans le vignoble réputé de Bordeaux… Un problème majeur qu’il va falloir gérer au plus vite en même temps que l’arrachage.

Bernard Sirot
Journaliste et dégustateur Vintaste
Photo JB Nadeau
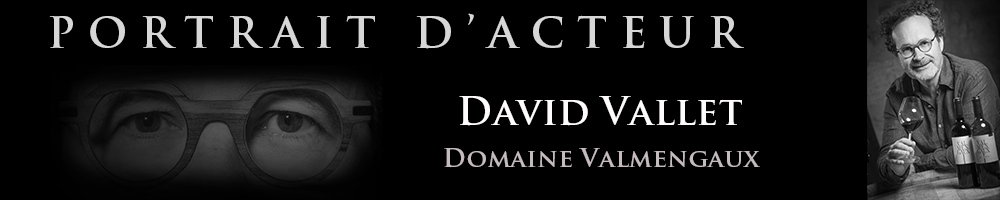
 David Vallet est devenu vigneron à 45 ans. Ressentant comme beaucoup, au mi-temps de leur parcours professionnel, l’envie de « changer de vie et d’activité pour quelque chose de beaucoup plus concret, » il met avec son épouse Valérie, ce projet à exécution à la faveur du soutien de leurs proches. Souhaitant faire partie de cette aventure à laquelle tous croient, famille et amis lui apportent leur soutien via un groupement foncier viticole regroupant 33 associés.
David Vallet est devenu vigneron à 45 ans. Ressentant comme beaucoup, au mi-temps de leur parcours professionnel, l’envie de « changer de vie et d’activité pour quelque chose de beaucoup plus concret, » il met avec son épouse Valérie, ce projet à exécution à la faveur du soutien de leurs proches. Souhaitant faire partie de cette aventure à laquelle tous croient, famille et amis lui apportent leur soutien via un groupement foncier viticole regroupant 33 associés.
Bourguignon d’origine, pour sa reconversion, David Vallet se laisse porter par « son goût pour le vin ». Sans liens familiaux avec cet univers, il s’oriente vers cette activité après une première partie de vie à travailler dans le contrôle de gestion et les systèmes d’information pour la grande distribution et le jeu vidéo
Arrivé à Vérac « un peu par hasard », le couple reprend le domaine en 2017, porté par un véritable « coup de cœur » pour Valmengaux, ses beaux terroirs argilo-calcaire situés à 20 km au nord-ouest de Saint-Émilion donnant « des vins d’une fraîcheur et d’une complexité peu communes dans l’appellation Bordeaux. »
Tandis que Valérie conserve son travail dans les ressources humaines en parallèle de la propriété, David s’y consacre pleinement. Il se forme auprès de l’ancien propriétaire s’appuyant aussi sur l’expérience acquise quand il nourrissait son projet de reconversion auprès d’un vigneron de la Loire.
Dans la conduite de Valmengaux, David peut aussi compter sur ses nombreuses lectures, de même que sur ses échanges avec ses voisins vignerons. « Bien sûr, je suis loin d’avoir tout appris ; j’ai besoin de me faire accompagner sur bien des points, notamment pour les travaux mécanisés, car le passage d’Excel à un tracteur n’est pas forcément évident ! »
Certifié bio depuis 2012, le domaine compte 4 hectares, dont 1,5 replantés par Valérie et David après leur arrivée. À Valmengaux, David pratique une viticulture et des vinifications peu interventionnistes. Pour façonner ses deux cuvées, reflet de ce terroir, il travaille peu les sols, recourt à des levures indigènes et mène un élevage de 12 à 24 mois sans toucher aux vins .
Les vins de Valmengaux se différencient également par leur élevage. Dans les chais de ce domaine précurseur, une partie des jus sont vieillis en amphores depuis 2014. À leur arrivée, les époux Vallet investissent pour proposer deux cuvées, dont une élevée 12 mois exclusivement en jarres.
Ainsi vieillis, les assemblages, 90% merlot et 10% cabernet, présentent une bouche plus ronde comme des tannins plus poudrés. L’autre cuvée est élevée dans des foudres âgés d’une dizaine d’années qui lui confèrent une belle souplesse et très peu de boisé
À la vigne comme aux chais, David Vallet s’attache « à adopter des pratiques qui permettent au mieux d’exprimer le terroir et ses vignes âgées de 40 à 60 ans. » Ses vins, des « Bordeaux sortant de l’ordinaire » s’exportent bien. États-Unis, Irlande, Allemagne, Autriche ou encore Italie, ils se vendent même mieux à l’étranger qu’en France.
À leur arrivée, Valérie et David plantent des pieds de malbec et de chenin. « L’idée était de se démarquer, de faire des vins qu’on a envie de boire, de faire du blanc avec un cépage que j’aime particulièrement. » Avec un peu de recul, le malbec semble présenter une réponse intéressante aux défis climatiques. Gel, mildiou, grêle, si les jus ont été bons, au cours des quatre années écoulées depuis leur arrivée, chaque millésime a connu ses aléas.
À terme, le malbec pourrait permettre de conserver des rendements viables malgré le contexte climatique compliqué. David Vallet entend poursuivre cette réflexion sur les cépages et autres pratiques permettant de répondre au mieux réchauffement climatique.
Il envisage aussi de rejoindre le groupe des Bordeaux Pirates, un mouvement de vignerons bordelais sortant des sentiers battus avec lesquels il se sent de nombreuses affinités. Le couple a également aménagé un gite sur l’exploitation, un moyen supplémentaire de pérenniser Valmengaux, comme de faire découvrir son activité aux hôtes qui le souhaitent.


(c) JB Nadeau
Médoc : 2023 s’est engagé avec un débourrement et une floraison extrêmement précoce. Le weekend de l’Ascension a été marqué par le début de la floraison sur les terroirs précoces. A ce stade, le nombre et la taille des grappes laissait entrevoir une jolie récolte que la coulure est venue légèrement modérer. Le mois de juin tourmenté avec de nombreux épisodes orageux a augmenté aussitôt la pression maladie au vignoble. Juillet a été moins arrosé, mais continuellement humide. Le millésime 2023 s’est construit dans le travail. Le mildiou a été le fil rouge des vignerons et les a obligés à être vigilants et combatifs d’un bout à l’autre de la campagne. Localement et en fonction des méthodes culturales, sur certaines propriétés en Gironde, les pertes ont été importantes. La boîte à outils s’est resserrée pour lutter contre cette maladie.
Cela étant dit, nous constatons en sillonnant le vignoble une récolte abondante en Médoc et les rendements devraient être, à l’échelle de cette région, les plus hauts depuis un bon nombre de millésimes. Depuis la mi-août, nous traversons une période historiquement chaude pour une fin d’été. 2023 est un millésime précoce, seulement quelques jours plus tardifs que l’historique 2022.
Les blancs sont désormais terminés et tant au niveau de la qualité que des volumes, nous sommes satisfaits. Une certaine hétérogénéité causée par la charge nous a amenés à réaliser, le plus souvent, des vendanges par tris. Les jus à la sortie du pressoir offrent une belle acidité et une aromatique nette qui devrait se révéler durant la fermentation alcoolique.
Pour les rouges, sur les terroirs les plus précoces, les merlots sont dans les chais et les cabernets devraient suivre dès la fin de la semaine. Au niveau de la qualité, la période de forte chaleur a permis de bien terminer certaines maturités et les pluies de cette mi-septembre sont de bon augure pour la maturité des cabernets sauvignons.
Graves, Pessac et Sauternes : Les Blancs sont maintenant terminés, ils sont de très belle facture, aromatique et possédant une belle fraicheur apportée par une quantité d’acide malique supérieure à ces dernières années. Les volumes sont confortables, surtout pour le sauvignon qui a atteint un rendement plutôt exceptionnel. En rouge, les merlots sont en train d’être vendangés à vive allure, les fortes chaleurs et le vent des derniers jours ont accéléré la maturité. Les premières cuves sont très belles avec une couleur très soutenue. En Bordeaux, entre les zones atteintes par le mildiou et une forte pression de ver de la grappe, le rendement des Merlots est faible. En Graves et Pessac Léognan, cette chute de rendement semble plus modérée. Pour le Sauternais, une première trie va avoir lieu à partir de ce lundi 18 septembre. Il s’agit de ramasser du très joli passerillage en attendant que le botrytis, qui commence juste à s’installer, face son œuvre de concentration.
C’est un millésime compliqué. Nous avons été heureusement épargnés par le gel et nous avons réussi à faire face au Mildiou, notamment grâce à nos vignes enherbées qui ont facilité nos interventions. Au final la récolte est préservée, même si nous avons été assez inquiet ces derniers jours avec la persistance d’un temps chaud et humide. Ce dernier mois avec ses épisodes de fortes température nous ont fait cependant perdre du volume. A ce jour nous avons récolté nos merlot issus de graves sableuses avec une grande satisfaction la récolte est belle avec une très belle concentration. Cela représente 40 % de notre récolte, maintenant nous attendons le cabernet sauvignon (environ 60% de nos vignes) et le petit verdot (2%).
J’ai juste vendangé un tout petit peu de chenin pour le moment, les rouges seront ramassés demain et après-demain. Il est trop tôt pour faire un bilan donc mais je sais déjà que j’aurai de très faibles rendements, le mildiou ayant ravagé certaines parcelles. La qualité des jus s’annonce très belle, les pluies de ces derniers jours devant calmer des degrés encore élevés pour le moment. A suivre…
Un millésime qui nous en a fait voir de toutes les couleurs !!! Cette année viticole nous a laissé peu de répit : gelées en avril, orages quasi quotidien en mai et juin, donnant même localement de la grêle. Nous avons subi des journées tropicales puis un été frais et humide, et à nouveau des journées caniculaires ! Nombreux se sont invités à la fête : mildiou, oidium, papillons, guêpes… Un vrai parcours du combattant.
Mais 2023 a été aussi très généreux avec une sortie de fleurs incroyable en début de saison, résultat du millésime solaire précédant. C’est un millésime qui a mis en exergue les forces et les faiblesses de nos cépages, de nos parcelles, mais surtout l’agilité du vigneron qui a conduit ses raisins tout au long de cette saison, s’adaptant au jour le jour à ce climat capricieux afin de produire le meilleur sur l’ensemble de ces parcelles. C’est une année qui a donné beaucoup mais qui a su aussi reprendre. 2023 un millésime méritant et mérité qui offrira une grande diversité et beaucoup de personnalité.

Après Venise, Curitiba (Brésil), Shanghai en Chine, Berlin ou encore Paris et Barcelone, Gérard Rancinan et Caroline Gaudriault ont de nouveau posé leurs valises en Aquitaine. Le photographe et l’auteure, qui ont déjà exposé à l’ancienne Base sous-marine de Bordeaux, dévoilent cette fois-ci le fruit de leur travail au sein du Dôme de Saint-Emilion, un chai au cœur des vignes imaginé par Jonathan Maltus (château Teyssier à Saint-Emilion et en Californie World’s End) et conçu par l’architecte Lord Norman Foster.

(c) JB Nadeau
Cette exposition exposition présente des photographies de Gérard Rancinan accompagnées d’installations d’écritures de Caroline Gaudriault. « Le choix de ce lieu d’exception n’est pas le fait du hasard. En 2021, à l’occasion de l’ouverture du chai qui abrite le cru Le Dôme, Gérard Rancinan réalisait le portrait de Jonathan Maltus. Aujourd’hui encore, ce portrait pérenne accueille les visiteurs à l’entrée du bâtiment. C’est donc très logiquement que l’artiste Gérard Rancinan a été choisi pour exposer ses photographies magistrales de natures mortes, accompagné par l’auteur d’installation d’écritures Caroline Gaudriault.
Les deux artistes, qui collaborent ensemble depuis plus de vingt-cinq ans, s’interrogent avec ce dialogue entre images et mots sur la vie et notre regard sur les objets. « Et si l’absolu nous permettait de construire une résistance ? Une résistance à la fragilité et à l’oubli. Les objets sans vie et les éléments naturels deviennent sacrés sous le regard de l’homme qui s’en empare et s’invente mille histoires. (…) Tout repose sur l’imagination. Il faut imaginer le vin à partir de la vigne, l’architecture à partir de l’acier, la langue à partir du signe. Tout s’assemble avec la lumière, la géométrie et la construction et la construction, pour ensuite trouver dans les compilations de natures mortes, nous inventons la narration et créons des souvenirs », raconte notamment un texte présentant les interrogations présentes au cœur de cette exposition.
L’Absolu est à voir au Dôme à Saint-Emilion. L’accès à la mezzanine est gratuit. La visite de l‘exposition, accompagnée d’une dégustation de vins, coûte 50 euros.
Photos Jean-Bernard Nadeau

(c) JB Nadeau
Malgré la guerre, les performances exceptionnelles de l’Ukraine sont à saluer. Le pays a reçu une médaille d’or pour son label Troyanda Carpat produit par le Château Chizay.
Les vins doux primés affichent une variété et une douceur très variable (entre 15 et 400 g/l de sucre résiduel). « Quelle que soit la teneur en sucre, l’équilibre est l’aspect le plus important », a souligné l’un des juges. En fait, le panel a convenu que la catégorie mérite une attention particulière afin qu’elle puisse à nouveau séduire les consommateurs.
Sans surprise, Madère et Porto ont ouvert la voie, mais des appellations moins connues comme Moscatel de Setúbal et Carcavelos ont également réalisé des performances remarquables.
Pour Bordeaux, deux médailles d’Or, Château Renon liquoreux 2019 (AOC Cadillac) et Château de Rouquette 2020 (AOC Loupiac).
Cette année, la région Piémont s’est vu décerner le trophée de la révélation internationale pour un Vino Passito. Ce style de vin italien est produit à partir de raisins secs. Le processus concentre les sucres naturels du raisin, conférant au vin des arômes doux et intenses. Le label Tramp Passione Volontà du Domaine Bragagnolo a remporté les votes du jury du Concours Mondial pour son équilibre et sa finesse.

Le Concours Mondial de Bruxelles est un concours international où plus de 10 000 vins sont présentés par les producteurs pour être jugés par un jury d’experts. Des juges expérimentés dégustent les vins du concours avec un seul principe : distinguer des vins d’une qualité irréprochable, sans parti pris lié à l’étiquette ou au prestige d’une appellation. Le Concours est l’un des événements internationaux les plus importants en son genre.
 Cette viticultrice de Charente-Maritime avait le besoin de pérenniser les emplois sur son exploitation et l’envie de parfaire ses compétences de manager. Cette viticultrice de 51 ans regrette de ne pas avoir été suffisamment formée au management lors de ses études.
Cette viticultrice de Charente-Maritime avait le besoin de pérenniser les emplois sur son exploitation et l’envie de parfaire ses compétences de manager. Cette viticultrice de 51 ans regrette de ne pas avoir été suffisamment formée au management lors de ses études.
En 1999, le père de Gary Charré, codirigeant de la ferme de l’Orée, prend une retraite anticipée. Après son départ, la ferme, qui compte alors 26 hectares de vignes et 114 hectares de grandes cultures, n’emploie plus que de la main-d’œuvre saisonnière. « Quand je me suis installée, la crise du cognac n’était pas favorable à l’emploi permanent. Jusqu’en 2005, nous avons eu recours à des employés saisonniers pour les opérations de taille et de relevage de la vigne. Nous avons pris conscience que pérenniser les emplois de nos collaborateurs était une nécessité. »
À la ferme de l’Orée, l’activité viticole représente 70 % du chiffre d’affaires annuel, qui s’élève à 400 000 euros environ. Pour cette raison, une équipe de permanents sécurise l’exploitation, en plus d’améliorer la qualité des interventions. En effet, la taille doit être minutieuse. Des travaux mal réalisés compliquent le travail le reste de l’année et les suivantes.
Aujourd’hui, Pascale Croc et son mari emploient leur fille, une journée par semaine, et trois collaboratrices qui travaillent aussi chez un voisin. « Ce type d’organisation salariale requiert une communication fluide et régulière entre les adhérents du groupement. Nous devons établir des plannings et prioriser les urgences », confie Pascale Croc, qui souligne la nécessité de se montrer conciliant.
 L’organisation du travail se réfléchit aussi en interne. Pascale Croc et Gary Charré savent tout faire sur l’exploitation, pourtant, chacun est référent dans un domaine. « Nommer des responsables est un moyen d’éviter la perte de temps et les malentendus. Ainsi, nos collaboratrices savent à qui s’adresser quand elles en ont besoin.
L’organisation du travail se réfléchit aussi en interne. Pascale Croc et Gary Charré savent tout faire sur l’exploitation, pourtant, chacun est référent dans un domaine. « Nommer des responsables est un moyen d’éviter la perte de temps et les malentendus. Ainsi, nos collaboratrices savent à qui s’adresser quand elles en ont besoin.
Pour cette cheffe d’entreprise, animer une démarche de management implique de définir un projet d’entreprise et de communiquer sur ce projet pour y faire adhérer ses collaborateurs : « En 2012, lors de notre conversion vers l’agriculture biologique, la plus ancienne de notre équipe a nourri beaucoup d’inquiétudes. À force de discussions, elle a compris nos motivations.
Après trois ans d’interruption, l’organisation d’un séminaire annuel reprend cette année : « Nous avions arrêté pour diverses raisons ; entre autres, le format d’une journée avait été jugé trop long. Désormais, ce séminaire se présente sous la forme d’une demi-journée suivie d’un repas partagé. Pour l’occasion, nous élaborons un ordre du jour dans lequel nous abordons les grands projets à venir et les objectifs à long terme.
En début de chaque semaine, une réunion précise l’organisation du travail pour la semaine à venir. « Par exemple, si l’on intervient trop tard sur une parcelle et que cela augmente la pénibilité, nos collaboratrices pourraient me le reprocher. Elles sont plus souvent sur le terrain que moi. », sourit la viticultrice.
Pascale Croc et son mari se sont formés au management dans le cadre d’une formation proposée par Trame. Pour la viticultrice, les techniques managériales renforcent ses compétences de femme leader et sa confiance en elle.

Dans le cadre de son action d’ouverture au grand public, l’ISVV – Institut des Sciences de la Vigne et du Vin a choisi de se lier fortement à la Cité du Vin et à son dynamisme permettant ainsi d’atteindre le plus grand nombre et de véritablement faire profiter un public curieux et passionné des fruits de la recherche d’une école bordelaise réputée dans le monde entier et de ses partenaires français et étrangers. Les sciences de la vigne et du vin dans toute leur interdisciplinarité avaient besoin d’un espace de rencontre et de partage inédit et original rapprochant les chercheurs du grand public pour une médiation des débats scientifiques. Avec plus d’une trentaine de conférences données et 15 000 auditeurs (dont près de 70% via les podcasts de la Cité du Vin), les Vendanges du Savoir sont devenues un rendez-vous incontournable.
Les Vendanges du Savoir sont une action culturelle nouvelle portée par l’université de Bordeaux, l’Université Bordeaux Montaigne et la Fondation pour la culture et les civilisations du vin, sous l’impulsion de l’Institut des Sciences de la Vigne et du Vin (ISVV). Ce projet bénéficie du soutien de la société Baron Philippe de Rothschild S.A.
 Une consommation à la hausse sur 10 ans mais en retrait à court terme
Une consommation à la hausse sur 10 ans mais en retrait à court termeAprès plusieurs années de croissance ininterrompue, la consommation mondiale de vins rosés s’est tassée en 2020 et a baissée en 2021. Plus particulièrement dans des pays comme la France, les États-Unis ou l’Italie. Néanmoins, des foyers de croissance perdurent (notamment en Belgique, dans les pays d’Europe centrale et orientale, en Scandinavie et en Asie-Océanie) et certains marchés sont repartis à la hausse entre 2019 et 2021 (Allemagne, Royaume-Uni et Pays-Bas). De façon générale, les vins rosés constituent un « amortisseur de crise » pour les vins tranquilles.
Largement en tête des pays consommateurs, la France conserve en 2021 sa place de premier pays consommateur de vin rosé au monde avec 34 % de la consommation mondiale. Le podium reste inchangé mais l’ordre varie avec l’Allemagne qui a doublé les États-Unis.
La production mondiale de vins rosés continue de s’inscrire à la hausse. Cela pose question, dans un contexte de repli de la consommation. La production reste concentrée autour de trois pays (66 % de la production mondiale est due à la France, à l’Espagne et aux États-Unis). Plusieurs pays voient leur production de rosé progresser, dans l’hémisphère sud (Chili, Nouvelle-Zélande) et en Europe de l’Est (Hongrie, Roumanie, Bulgarie).
La France consolide sa position de leader : premier producteur, premier consommateur, premier exportateur en valeur (deuxième de loin derrière l’Espagne en volume : ce pays pèse le double de la France sur ce critère) et premier importateur en volume (surtout de vins espagnols d’entrée de gamme). L’Italie, qui voyait ses exportations stagner au début des années 2010, connait un rebond assez marqué et prend la troisième
place des pays exportateurs. Les échange continuent de se développer : environ 50% des vins rosés passent désormais au moins une frontière avant d’être consommés.
Les États-Unis se réorientent vers des rosés « secs » bien mieux valorisés que les traditionnels blus ou white zinfandel. Après avoir fortement progressé entre 2015 et 2019, les importations de vins rosés s’y sont fortement repliées en 2020 et 2021.
Créé en 2002 par le Conseil Interprofessionnel des Vins de Provence (CIVP) et FranceAgriMer, l’Observatoire Mondial du Rosé rassemble, analyse et diffuse les données relatives à la production, à la consommation et aux échanges de vins rosés dans le monde. Couvrant 45 marchés dont la France, il permet de suivre les évolutions et les tendances d’une catégorie de vins en forte croissance et d’éclairer la prise de décision stratégique :
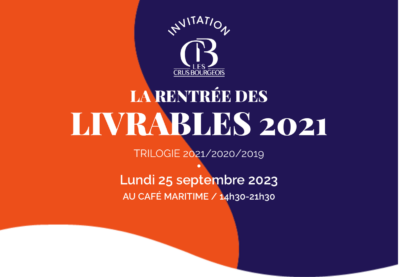 Cette dégustation est réservée aux professionnels du secteur viticole (négociant, journaliste, caviste, étudiants, etc), accessible uniquement sur invitation.
Cette dégustation est réservée aux professionnels du secteur viticole (négociant, journaliste, caviste, étudiants, etc), accessible uniquement sur invitation.
L’événement rassemblera plus de 150 châteaux Crus Bourgeois. Il sera possible d’y retrouver les millésimes 2019, 2020 et bien sur 2021.
La soirée se prolongera en cocktail dinatoire avec bar à vins des Blancs et Rosés des Crus Bourgeois du Médoc et DJ Set toute la soirée.